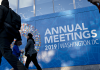La bataille d’un an pour Tripoli s’est intensifiée ces dernières semaines malgré les appels généralisés à un cessez-le-feu pendant le Ramadan et la pandémie de coronavirus. Alors que la violence s’intensifie et que le nombre d’étrangers impliqués dans les combats se multiplie, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est révélé largement sans conséquence. Les raisons en sont aussi complexes que la politique de la guerre civile de six ans en Libye.
Ces dernières semaines, les combattants alliés au gouvernement d’accord national de la Libye, reconnu internationalement, ont réalisé des progrès importants contre leurs rivaux au sein de l’Armée nationale libyenne, dirigée par le feld-maréchal autoproclamé Khalifa Haftar. Les deux parties sont des coalitions de milices largement lâches dont la politique intérieure est encore plus complexe que le fossé à l’origine de la guerre.
L’escalade des combats dans le nord-ouest de la Libye coïncide avec des niveaux croissants d’intervention militaire étrangère et de soutien matériel offerts aux deux parties par de puissants alliés. L’armée nationale libyenne a été le plus visiblement soutenue par l’Égypte et les Émirats arabes unis. Il a également bénéficié de mercenaires russes bien entraînés.
Pour contrer ces mesures, la Turquie a accru son soutien au gouvernement d’accord national. Ankara a offert des armes avancées, une coordination logistique et même des combattants rebelles vétérans de Syrie. Ce soutien a contraint les milices de Haftar, ainsi que les mercenaires russes, à effectuer une série de retraites dramatiques.
Des voix éminentes au sein de la communauté internationale ont réitéré les appels du Secrétaire général des Nations Unies à une trêve, en particulier dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Les chefs de sept agences des Nations Unies ont publié une déclaration soulignant la catastrophe humanitaire qui se déroule dans le pays.
Le conflit hautement internationalisé en Libye a de nombreux propriétaires. Mais le processus de paix a manqué de leadership clair et cohérent.
Échecs internationaux
Le Conseil de sécurité de l’ONU est resté largement silencieux sur la Libye depuis plusieurs mois. Plus choquant encore, il n’a pas encore trouvé de nouveau médiateur en chef pour la Libye. Cela fait suite à la démission, début mars, de Ghassan Salamé, qui a pris ses fonctions en 2017.
À la mi-mars, il a été révélé que Ramtane Lamamra, un ancien ministre algérien des Affaires étrangères, était à l’affût de ce poste. Mais sa candidature a été torpillée en avril par les États-Unis. C’était à la demande de deux alliés clés de Haftar, les Émirats arabes unis et l’Égypte.
La question est alors la suivante: pourquoi aucun pays n’est-il apparu comme un champion crédible de la paix?
Sur les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, tous sauf la Chine ont un bagage historique important en ce qui concerne la Libye.
Pendant la période coloniale italienne après la première guerre mondiale, la Libye a fonctionné comme un état tampon entre les intérêts impériaux français et britanniques concurrents en Afrique du Nord. Lorsque la Libye a accédé à l’indépendance en 1951, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont tous deux contribué à préparer le pays à devenir un allié solide pendant la guerre froide. Dans les années 1960, c’était un important exportateur de pétrole.
Mouammar Al-Kadhafi a mené un coup d’État militaire qui a renversé la monarchie libyenne en 1969. Alors qu’il devenait plus ouvertement antagoniste des intérêts de l’Atlantique Nord, Moscou a heureusement armé les militaires du pays jusqu’aux dents dans les années 1970.
Lorsqu’une révolte populaire a renversé le régime de Kadhafi en 2011 avec l’aide de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, Moscou a perdu plus de 10 milliards de dollars en accords sur les armes.
L’État libyen qui a émergé après 2011 s’est rapidement effondré dans différents camps belligérants en 2014. Bien que plusieurs États européens et du Golfe aient été rapidement intervenus militairement pour défendre le soulèvement libyen de 2011 avec le soutien des États-Unis,
l’administration Obama a appris plus tard qu’elle n’était pas aussi désireuse de soulever la lourde charge de la construction de l’État non partisan dans les années qui ont suivi.
Avec la propagation ultérieure de l’État islamique en Libye et le flot de migrants quittant ses côtes en 2015, l’attention européenne et américaine a commencé à se concentrer exclusivement sur les tâches à court terme de la lutte contre le terrorisme et la contre-migration. Cela s’est fait au détriment de la réconciliation libyenne à long terme.
Cette réflexion à court terme a également légitimé et responsabilisé divers participants rivaux à la guerre civile en Libye en faisant d’eux des partenaires clés dans la campagne contre l’État islamique et pour contrôler les migrations maritimes.
Jusqu’au présent
L’administration Trump s’est révélée encore plus désengagée et ambivalente. Alors que divers médiateurs potentiels tentaient de combler le vide du leadership – du président français Emmanuel Macron au premier ministre italien Giuseppe Conte – l’armée nationale libyenne de Haftar a lentement renforcé son emprise sur de grandes parties du pays. Cela comprenait les principales installations pétrolières.
Lorsqu’il est apparu que Salamé tenterait de contourner Haftar et d’entamer un processus de dialogue national, l’armée nationale libyenne a lancé son assaut sur Tripoli en avril dernier avec le soutien de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de la Russie.
Malgré ces actions agressives et les nombreuses pertes civiles causées par les forces de Haftar, la condamnation de l’Europe et des États-Unis d’Amérique n’a pas été prononcée. Des informations récentes dans le New York Times suggèrent que la Maison Blanche a plus ou moins donné le feu vert à Haftar pour attaquer Tripoli.
La chancelière allemande, Angela Merkel, a dirigé les efforts les plus récents pour relancer le processus de paix en Libye au début de l’année en janvier. Il y avait de l’espoir que l’Allemagne puisse exercer sa neutralité pour réunir le Premier ministre libyen de renommée internationale, Fayez al-Serraj et Haftar, ainsi que leurs principaux bailleurs de fonds, respectivement la Turquie et la Russie. Au minimum, le processus de Berlin, comme on l’appelait, pourrait trouver un moyen de faire respecter l’embargo sur les armes imposé par les Nations Unies à la Libye alors que les violations flagrantes se poursuivaient.
Mais il est vite devenu évident qu’Ankara et Abu Dhabi n’allaient pas reculer. Serraj et Haftar non plus.
Aujourd’hui, il semble que l’intervention turque soit sur le point d’effacer tous les gains que le soutien étranger avait achetés à l’armée nationale libyenne l’année dernière. Compte tenu de la récente déclaration de Haftar de règne militaire sur les zones qu’il contrôle, des jours plus sombres pourraient être à venir, en particulier lorsque des puissances extérieures insistent pour jouer leur grand jeu pour le Moyen-Orient en Libye.