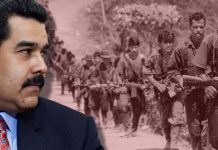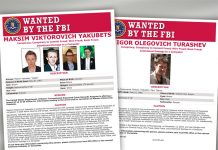La guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen a été motivée par des préoccupations concernant l’approvisionnement et la livraison de pétrole. Les tensions régionales contre l’Iran ont fait que le détroit d’Ormuz devient une voie peu fiable pour 30% des approvisionnements en pétrole de la planète.
L’ironie de la campagne militaire de l’Arabie saoudite au Yémen est que, plutôt que de promouvoir la sécurité pétrolière, elle a engendré un opposant tenace au sein du mouvement houthis. Comme le prouve la frappe de septembre sur les gisements de pétrole saoudiens, les milices tribales houthis sont capables de frapper le territoire saoudien et de perturber l’approvisionnement mondial en pétrole, coûtant à la monarchie des milliards de dollars en dommages et pertes de revenus.
Tandis que le gouvernement et les médias continuent de pointer du doigt et de faire des conjectures sur le coupable ultime, la vraie question qui reste est de savoir pourquoi le ministère saoudien du pétrole a été préparé et surpris par une telle attaque.
Depuis 2009, les membres de la tribu houthi constituent une menace le long de la frontière sud de l’Arabie saoudite, s’infiltrant dans le sol à travers une région désertique poreuse et pénétrant dans l’espace aérien saoudien avec des missiles Scud et des drones sans pilote. L’attaque des installations pétrolières d’Abqaiq n’était pas la première et ne sera certainement pas la dernière manifestation de la vulnérabilité de l’Arabie saoudite.
Peu de temps après l’attaque du drone, le président russe Vladimir Poutine a expliqué que l’Arabie saoudite aurait dû acheter un système avancé de défense aérienne russe. L’humour de Poutine n’a pas été déplacé, surtout si l’on considère les milliards de dollars que l’Arabie saoudite a dépensés pour le système de défense antimissile Patriot de Raytheon, montant qui n’a augmenté que dans les semaines qui ont suivi l’attaque. Alors que les systèmes russes S-300 et S-400 n’ont pas encore été testés sur le champ de bataille, rien ne garantit que la défense aérienne aurait pu intercepter un drone.
En réaction à la dernière attaque du mouvement Houthis sur le territoire saoudien, il est utile de se pencher non seulement sur la dernière décennie de conflit le long de la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite, mais également sur le dernier moment où la monarchie saoudienne était menacée par la force aérienne et des infiltrations au sol depuis la frontière au Yémen.
Au cours des années 1960, l’Égypte a déployé un tiers de ses forces aériennes au Yémen pour soutenir activement une république yéménite fondée en 1962. La guerre civile qui a suivi entre les membres des tribus du nord du pays et les dirigeants républicains a entraîné l’Arabie saoudite dans le conflit alors que la coalition tribale cherchait refuge de l’autre côté de la frontière nord du Yémen. Les avions de chasse et les bombardiers égyptiens ont poursuivi des membres de la tribu sur le territoire saoudien, bombardant les marchés le long de la frontière et bombardant les dépôts de ravitaillement.
L’Arabie saoudite a lancé un appel à l’assistance militaire directe au président John F. Kennedy, craignant qu’une attaque égyptienne ne menace la monarchie et les réserves de pétrole du pays. Résistant à engager les forces américaines dans une autre guerre régionale, Kennedy accepta de ne placer qu’un seul escadron de combattants sur la base aérienne de Dhahran en Arabie saoudite dans le cadre de l’opération Hard Surface.
En privé, Kennedy a interdit aux pilotes d’engager des avions égyptiens, craignant de se perdre dans un conflit frontalier insoluble. La simple présence et le risque de recours à la force, même s’ils étaient peu probables, suffisaient à dissuader un conflit plus large entre l’Arabie saoudite et l’Égypte.
La force de dissuasion offerte par l’escadron de Kennedy a depuis été remplacée par des patrouilles navales, tandis que Dhahran, situé dans la province de l’Est, a été renommé base aérienne du roi Abdulaziz et sert maintenant de plaque tournante majeure pour la Royal Air Force saoudienne. La dissuasion elle-même reste toutefois une réponse importante et appropriée pour atténuer les conflits régionaux et éviter une escalade majeure de la violence. La mission aérienne de Kennedy à Dharan, en 1963, était accompagnée d’une mission d’observation des Nations Unies chargée de surveiller l’espace aérien saoudien et d’enquêter sur les raids que l’Égypte aurait commis à la frontière.
L’ONU peut jouer un rôle similaire à celui de gardien de la paix régional et surveiller les événements en apaisant les préoccupations de l’Arabie Saoudite dans le cadre d’un effort plus vaste visant à réduire le niveau de violence des deux côtés de la frontière saoudienne et yéménite. La sécurité ultime des installations pétrolières ciblées reste la responsabilité de l’Arabie saoudite, un fait qui conduira sans aucun doute à des achats d’argent extravagants, bien que parfois excessifs, par la monarchie.
La question de la maintenance ininterrompue et sécurisée des installations pétrolières et des systèmes de livraison deviendra encore plus importante alors que l’Arabie saoudite poursuit la construction d’un pipeline traversant al-Mahra, la province la plus à l’est du Yémen. La construction de cet oléoduc et du port de Nishtoon sur la côte sud du Yémen est l’aboutissement de deux décennies de négociations et d’efforts diplomatiques en Arabie saoudite.
L’ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh avait refusé d’accorder à l’Arabie saoudite la souveraineté sur le corridor territorial nécessaire à la construction et à la surveillance de ce pipeline. Les tensions avec l’Iran et les incertitudes quant à la fiabilité d’Ormuz en tant que passage pour l’approvisionnement en pétrole saoudien ont exercé une pression supplémentaire sur la monarchie saoudienne pour qu’elle cherche des solutions de rechange en matière de livraison.
Le déclenchement d’une guerre civile au Yémen en 2014 a offert aux Saoudiens une occasion unique de soutenir et de cultiver une nouvelle administration yéménite qui accepterait à terme de louer le terrain nécessaire à la construction de ce pipeline.
Bien que la guerre civile ne se soit pas déroulée comme prévu initialement, le président yéménite Mansur Hadi reste à Riyad et doit sa survie politique à son pays hôte, ce qui signifie qu’il ne serait nulle part pour décourager les projets d’oléoduc et de port saoudiens.
L’ambassadeur saoudien au Yémen, Muhammad al-Jabar, s’est rendu dans la province d’Al-Mahra en juin 2018 en tant que superviseur général du programme de reconstruction saoudien au Yémen, à la suite d’études de faisabilité menées par la société Saudi Aramco. Bien qu’il s’agisse d’une région relativement peu peuplée, Al-Mahra constitue toujours une menace potentielle pour l’oléoduc envisagé par l’Arabie saoudite.
L’attaque de septembre contre les installations de production de pétrole d’Abqaiq a été un appel au réveil du ministère saoudien du pétrole. L’auteur de l’attaque, qu’il s’agisse des Houthis ou de l’Iran, est sans importance.
L’Arabie saoudite est entrée dans ce conflit au Yémen à la recherche d’une solution de remplacement du détroit d’Ormuz et a involontairement créé une nouvelle menace pour la sécurité des installations pétrolières.
Si l’oléoduc al-Mahra devait devenir une réalité, les forces de sécurité saoudiennes hériteront de centaines de kilomètres de cibles de drones potentielles traversant un territoire étranger potentiellement hostile. Le paiement des loyers, sous forme de pots-de-vin aux chefs de tribus locales, sera coûteux, de même que la logistique de la surveillance de l’espace aérien entourant le pipeline.
La monarchie saoudienne est responsable de la sécurisation de ce pipeline et de ces autres installations pétrolières, tandis que les États-Unis et les Nations Unies peuvent et devraient fournir uniquement un moyen de dissuasion et de surveillance suffisant pour prévenir un conflit régional plus vaste.